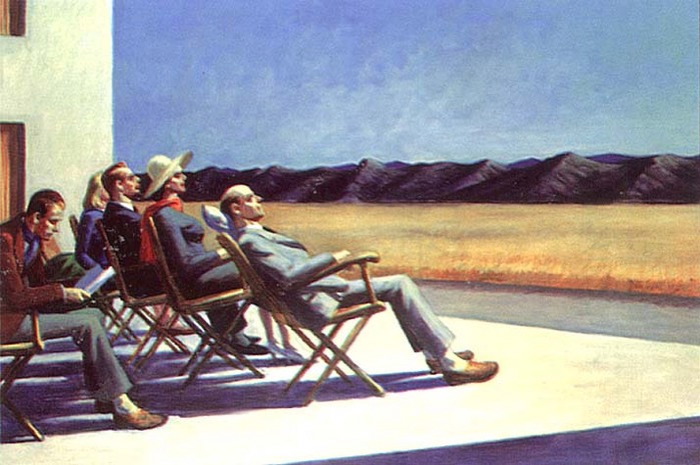
L’ART DE LA VOYANCE
EDWARD HOPPER
et
LES LIMITES DE LA REPRESENTATION
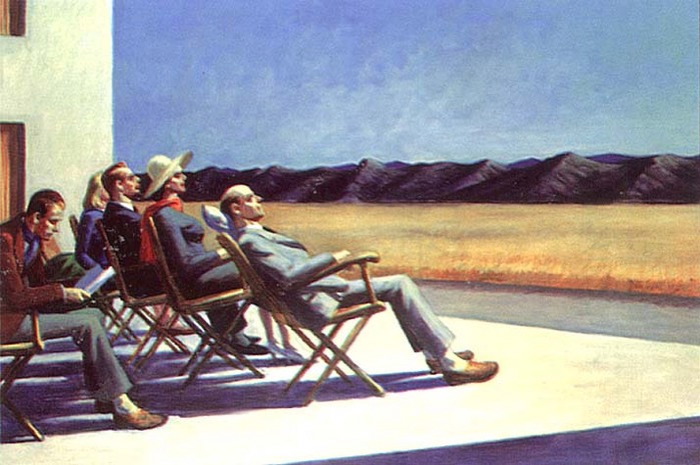
People in the sun (1959)
I – l’effet d’extériorité
Trois des cinq personnages regardent en dehors du
cadre en direction d’une lumière que l’on devine être celle du soleil.
Le faisceau de ces regards, tendus et saillants, rassemble l’unique
mouvement de la toile et contient sa dynamique essentielle. Il lui
confère alors son étrange intensité : des fronts relevés et peints
de profil, partent trois fils invisibles qui courent entre la colline
sombre et la prairie jaune paille, le long d’un axe de fuite latéral,
traversant et creusant toute la surface de la toile pour aller se
perdre au-dehors, au-delà du cadre. La densité presque brutale de ce
faisceau, qui n’est qu’un invisible mouvement au sein de notre propre
vision, vient de ce que ces regards jaillissent précisément de cavités
profondes et sombres, d’yeux noirs et absents à la surface des
paupières ; et de ce que ce jaillissement, à son tour, troue et
renforce l’impassibilité des visages. Les faces blêmes en sont comme
transpercées.
Mais ces trois personnages ne sont pas simplement en train de regarder.
Ils sont littéralement happés, hypnotisés et plongés dans une
contemplation muette, baignés d'une lumière laiteuse et diaphane venue
d’ailleurs. Ils s’engouffrent eux-mêmes dans leur propre regard, comme
s'ils ne pouvaient résister à l’appel de cette fuite en avant.
Installés au bord d’une terrasse de campagne sur des fauteuils en bois,
leur présence dégage une force implacable, à la fois léthargique et
profondément statique, comme une énergie privée de toute possibilité de
mouvement. Et c’est du fond de cette passivité létale que s’anime
sourdement la tension des regards : à l’immobilité physique des
personnages et à tout ce que la scène recèle d’éternellement figé,
vient alors répondre l’intensité troublante de ces trois lignes
invisibles et de leur mouvement de fuite irrémédiable. A travers ces
regards qui nous emportent avec eux, apparaît ainsi ce qui ouvre
irrémédiablement la toile à tout ce qui n’est plus elle, à ce qui
n’appartient plus au simple registre de la représentation. Ce sont eux,
en effet, du fond de leur obscures cavités, qui génèrent et réalisent
ce minutieux mystère, cet excès par lequel la représentation se dépasse
elle-même et délivre alors plus qu’elle ne contient. Car ce faisceau de
regards fait justement surgir hors du cadre l’au-delà même du cadre, le
hors-champ de la représentation, sa limite même : il engendre sa
propre extériorité. Une impression muette se loge alors en notre
vision, une illusion s'est fait jour pour elle, celle de ne pas voir ce
que semblent voir ces gens au soleil ; illusion qui se lève en
notre regard parce que déjà nous savons qu’il n’y a là rien à voir, que
ces gens ne voient rien puisqu’ils ne sont rien, parce qu’il ne s’agit
en définitive que de la possibilité de voir ce que nous savons par
ailleurs ne pas pouvoir être vu. Un invisible domaine de la
représentation surgit à travers elle comme son autre, comme son
invisible, et creuse désormais notre vision de tout ce qu’il lui refuse.
Cet espace qui se présente « au dehors »
comme étant celui que les personnages contemplent, et où semble avoir
lieu le spectacle qu’ils considèrent – le soleil donc, ce qu’indique
aussi bien le titre, source de lumière et de toute visibilité, astre
originaire qui engendre la relation de l’œil et du visible - il ne nous
est précisément pas donné à voir, nous ne pouvons y accéder : il
n’est nulle part visible. En lui-même et pour lui-même, cet espace qui
hante en creux les marges de notre vision à travers et au bout de ces
regards sur la toile, n’est donc qu’un angle mort de notre perception,
qu’un espace irréel et flottant qui n’a d’autre réalité que celle de
l’illusion où il paraît – illusion qui est donc bien réelle, à son
tour, puisqu’effectivement vécue et thématisable. Dans ce simple
apparaître donc, un espace hors toile semble surgir depuis la toile à
travers le sillon immatériel de ces trois regards, au bout de la
terrasse et comme en continuité avec elle, en marge de tout ce qui a
été peint. Mais marge et extrémité ne sont ici plus rien de spatial, et
ne se tiennent nulle part, ce lieu invisible n’est pas devant nous en
quelque endroit que ce soit, et ce hors-cadre ne saurait être nulle
part localisé ni même tenir dans une simple juxtaposition : il n’est en
réalité nullement corrélatif à l’espace même de la toile et n’est pas
même pensable en terme de spatialité.
A strictement parler, en vérité, ce hors-cadre n’est rien, ce n’est ni
une chose, ni un objet, ni une forme ou une figure. En réalité, il ne
fait qu'arriver, ou se produire, ne fait qu’avoir lieu et n’est en
définitive, et par essence, que l’événement de la toile au sein de notre vision.
Il apparaît et s'immisce entre la toile et notre regard, et n’est d’un
côté que l’espace insondable et sans réalité que nous croyons deviner
là où se tient le spectacle vu par les personnages – l’origine, donc,
solaire – et de l’autre, n’est plus que ce hiatus ou ce manque effectif
qui hante notre regard quand nous nous laissons aller à suivre ceux des
personnages. Sa présence nous est par deux fois subtilisée au profit du
non-être, une fois en la toile, une fois en notre vision.
Nous pouvons ainsi énoncer ce quil y a lieu de nommer ici l’effet d’extériorité
: « nous regardons des personnages qui contemplent une chose que
nous en voyons pas », et que nous ne verrons jamais, pouvons-nous
ajouter, puisque par définition il n'y a justement rien à voir, en
peinture, au-delà du cadre, nul hors-champ possible, nulle réalité
qu’un recadrage ou une modification dans l’angle de la prise de vue
pourrait venir révéler. Ce que nous ne voyons pas, c’est ce que nous pensons
ne pas pouvoir voir, c’est donc ce que la représentation laisse ici
paraître, mais en sursis, c’est ce qu’elle manifeste comme sa propre
extériorité, inaccessible en soi et pour soi. C’est ce que notre vécu
seul peut attester, dans l'expérience de la toile. Il ne peut donc
apparaître sans elle, mais il n’en est plus une partie homogène. Dire
alors que ces regards se dirigent vers ce qui se présente avec eux
comme au-delà du tableau, c’est dire qu’ils manifestent cet espace
comme l’au-delà même de la toile, comme ce que la représentation induit
mais ne contient pas, produit mais ne représente pas, comme ce qu’elle
laisse paraître mais qui désormais ne lui appartient plus. Effet
hétérogène à ses causes, l’extériorité est le pur et simple produit
négatif de la toile et de notre vision, ce qu’elle introduit
d’invisible dans le visible, en tant qu'effet d’invisibilité.
II – l’invisible et les limites de la représentation
Ce qui compte ici, ce n’est donc pas tant ce que
l’on voit, que le fait même l’on ne voie pas, que l’on puisse ne pas
voir. La vision est ici vécue dans une forme essentielle
d’incomplétude, comme ouverte à l’intérieur d’elle-même sur son propre
manque. Manque à la vision, qui n’est que l’effet en excès de la toile.
Car en voyant la toile, nous faisons aussi l’expérience que quelque
chose devrait ou pourrait être visible, et nous le
pressentons comme tel dans l’acte de voir parce que la toile creuse
désormais notre regard sur lui-même et y dépose l'élément qu’elle lui
refuse tout en le lui promettant, comme son espace de
visibilité propre mais inaperçu. Ce qui signifie alors très
précisément que nous voyons que nous ne voyons pas tout ce qu’il
devrait être possible de voir. Et c’est dans l’exacte mesure où nous
sommes là pour voir que quelque chose, depuis et en dehors du tableau,
nous échappe. L'extériorité n’est certes pas visible, et en ce sens on
peut alors la dire invisible, mais cet invisible justement demande à
être vu, requiert notre regard et ne s’adresse qu’à lui, n’ayant de
sens qu’en lui et par lui. C’est à partir du moment où nous venons
devant le tableau que nous voyons que nous ne pouvons voir cet espace
du tableau qui apparaît comme extérieur à lui. Et qu'alors, dans le
visible, se déploie quelque invisible. L’invisible est donc d’abord ce
qui hante la vision, c'est ce qui s'y fait jour en creux, sans pouvoir
s'y résorber. C’est ce qui en son sein s’y dérobe et qui se laisse
pressentir comme pouvant ou devant être visible, mais ne l’étant pas
actuellement.
L’invisible est donc l’effet virtuel et négatif de la représentation.
C’est ce qui manque à la vision ; mais ce manque n’est ici
engendré que par la vision elle-même. L’effet d’extériorité doit alors
être pensé comme ce qui fait défaut à l’acte de voir pour que celui-ci
puisse se donner sans reste et revenir à soi sans perte. Car de nous à
la toile et réciproquement, quelque chose échappe qui ne se donne pas
et ne sera jamais donné. Voir la toile n'épuise donc plus la
représentation ni l'acte par lequel elle se donne, puisque celui-ci ne
suffit plus désormais à combler et à effectuer la plénitude du regard
lorsque ce même regard s’ouvre, s’élance, et voit la toile, ou plutôt,
pour reprendre l’expression si appropriée de Merleau-Ponty, voit selon
elle plutôt qu’il ne la voit. Du fait de son extériorité, l’espace de
la représentation ne rayonne donc plus dans sa totalité, il ne se
contient plus lui-même, en lui-même. Il apparaît tout au contraire
comme étant immédiatement solidaire de cet invisible qui est sa propre
extériorité et qui en marque à la fois la finitude et l’au-delà. Tout
se passe devant nous comme si quelque chose encore n'avait pas été vu,
là où en réalité rien ne pourra jamais apparaître. Et cet invisible
flotte en nous et devant nous en tant que simple mise en présence d'une
attente.
En entrant dans le champ du visible, la toile en a
réveillé l’apparaître en le vrillant sur sa propre présence, elle a
introduit une rupture qui n’est déjà plus imputable au seul registre de
la représentation. Ce que le tableau provoque et institue au sein d’un
seul et même mouvement, qui va du spectateur au tableau et du tableau
au spectateur, en passant par ce faisceau où s’animent, à la surface la
toile, les trois fils invisibles qui conduisent nos yeux jusqu’à la
limite du cadre et déjà même au-delà, c’est précisément la rencontre
avec cet espace en réserve hors cadre, ce néant de visibilité. C'est le
contact irrémédiable avec ce rien de visible qui n’a pas encore été vu
et ne le sera jamais. Quelque chose demeure en notre vision comme ce
qu'elle n'épuise pas, une attente indéfinie désormais s'est fait jour
pour elle, et l'habite. Ce que la représentation met donc ici en scène
à travers ce mouvement de reprise et de synthèse des trois regards par
le notre, c'est quelque chose comme du visible, mais toujours en sursis
de l’être. Et l’expérience perceptive se solde alors par ce constat
que, pour reprendre l’expression célèbre de Bergson, tout n’est pas
donné. Voilà l’essentiel. A cause de, ou plutôt grâce à sa propre
extériorité, la représentation désormais ne s'offre plus comme un
spectacle intégral mais devient au contraire ce à quoi il manque cette
part nulle en soi, mais proprement efficace, d’invisibilité, pour
pouvoir alors se refermer sur soi et être pleinement et définitivement
elle-même. Du fait de l'extériorité, la représentation ne peut plus
être synonyme de totalité. La toile alors, ne se laissera pas
entièrement voir, puisque ce qu’en elle la représentation représente
n'est pas le fin mot de la vision ni de l’expérience perceptive. La
toile manifeste en permanence cet espace invisible comme son au-delà.
Avec ce qui nous est refusé, s'effectue alors la non adéquation de la
mise en scène du regard par lui-même, et l'impossibilité pour la
représentation de se représenter elle-même, de se reprendre
intégralement et de se clore définitivement sur soi pour subsister sans
reste. L'essentiel, c’est donc que compte et fasse sens pour notre
vision cet espace du dehors par lequel la représentation ne peut plus
avoir lieu seulement à l'intérieur d'elle-même, c’est-à-dire au sein du
visible et de ses contenus, figures et matière colorée, mais qu'elle
repose au contraire, lestée et comme grevée d'invisibilité, et
indéfiniment béante, sur son propre effet d’extériorité, ayant par là
cessé de se déployer dans la plénitude essentielle de son rayonnement.
La toile n’est plus ce tout fermé sur lui-même tel un champ clos de
visibilité, la scène vue s’ouvre et se dépasse brutalement vers cet
au-delà qui est simplement là en réserve, pure puissance du visible,
excédent de visibilité sans ni lieu ni objet. L’essentiel donc, c’est
que la représentation ait pu devant nous laisser effectivement à la
surface du visible la trace inaltérable de son apparition. Et par là,
qu’elle soit à la fois déjà plus et autre chose qu’elle-même
Sans faire directement partie intégrante du tableau,
l'extériorité est donc cet espace du dehors qui vient avec la toile
sans pourtant tenir en elle. Dispensée au-delà du cadre comme part
d’invisible qui ne peut apparaître qu’à travers le visible, et dans
l’acte du voir, elle n’est plus déterminée ni même déterminable à
l’intérieur de l’espace de la représentation. Ce qui est ici contemplé
par ces spectateurs installés sur la terrasse blanche, et qui n’est
donc apparemment visible que pour eux et depuis la toile, c’est tout ce
que la représentation comporte et produit de visibilité supplémentaire,
mais négative, car cette visibilité n’est justement rien et ne recouvre
rien, elle n’est qu’un pur effet d’invisibilité. L’extériorité n’est
pas l’apparition de quelque chose, elle est apparition de rien du tout,
simple mouvement de montée de l’invisible dans le visible. Et l'on peut
dire alors que Gens au soleil est bien la représentation d'un
spectacle qui, sans pouvoir avoir lieu sans nous, n'a pourtant pas lieu
pour nous, ce qui signifie en d'autres termes que la représentation de
la contemplation ne peut plus se donner comme contemplation de la
représentation, car celle-ci désormais souffre d'une incomplétude
profonde qui est le signe d'une rupture essentielle dans l'ordre du
visible.
Avec ce phénomène – au sens phénoménologique – d’extériorité, seul
l'élément du regard compte, et tout ce qui arrive en lui par deux fois
: une première fois dans la mise en scène de cette plénitude
contemplative au sein de la représentation et dans la scène représentée
– puisqu’il s’agit bien au fond d’une contemplation solaire – une
seconde fois dans la finitude de notre propre vision. Mais de l'une à
l'autre, émerge et vient jouer cet excédent de visibilité qui manifeste
l'écart entre ce que la toile produit d'un côté et ce que nous-mêmes ne
recevons pas de l'autre. Et si la représentation autorise ainsi cet
excédent de visibilité au-delà de ce que ce qui sur la toile est
actuellement visible, c'est donc qu’elle manifeste, d'un seul et même
trait, à la fois excès et négativité, et qu'il y a là dans le même
temps à la fois manque et dépense, surcroît de visibilité d'une part et
privation de l'autre. En tant que différence induite par la présence
d'un sujet voyant à qui elle manque, cet écart dans la vision est la
structure même de l'extériorité, et celle-ci n'est à son tour que le
rapport différentiel qui met en porte à faux le visible comme puissance
et le visible en tant que dépense actualisée. Entre les deux, s'est
introduit un déséquilibre irréversible que nul effort de l'entendement
ne saura résorber.
Que signifie cette différence, cet écart ?
En tout état de cause, que l'extériorité nous
met directement aux prises avec les limites de la représentation.
Quelque chose n’est pas représenté, qui n’est pas représentable.
Qu’est-ce qui échappe alors à la représentation, si la représentation
le produit avant tout comme son autre, en tant qu’effet d’invisibilité
qui ne fait que transparaître en elle ?
L'extériorité n’étant pas de nature spatiale, portion ou lieu réel de la représentation, un élément visible ou l’un de ses contenus, elle ne réside nulle part. Elle est d’abord, en réalité, un phénomène, un vécu de la perception, et si elle n’est nulle part, c’est d’abord parce qu'elle a lieu, c’est-à-dire, se présente comme événement de la vision, comme sa différence propre, son écart interne. Perceptible donc, mais invisible comme telle, événement qui échappe à toute thématisation objective du perçu, l’extériorité marque ainsi la limite de la représentation. Il y a un certain phénomène qui demande à voir mais qui n’est pas lui-même visible. Il y a un effet d’invisibilité qui découle du fait que nous sommes voyants, qui demande à être vu, qui fait que nous voyons l’invisible.
Le phénomène de l’extériorité, en tant
qu’épiphanie, ou levée de l’invisible dans le visible, ne peut donc
être ni représentée, ni représentable, ni encore moins être conçue
comme représentative. Elle n’est que l’irreprésentable même de la
représentation, et ne représente rien, mais ne peut l'être que
moyennant la représentation elle-même comme ce qui par nature lui est
hétérogène. En tant qu’effet de la représentation, elle se produit hors
de la toile comme son propre effet d'invisibilité, en lequel la
représentation se dépasse dans ce qui à la fois la nie et en opère la
transcendance. Ce phénomène ne relève donc plus ni de l’espace ni du
registre de la représentation, mais participe d’un tout autre régime,
celui de la manifestation : l’extériorité ne renvoie plus à la
spatialité de la représentation mais à la temporalité vécue de la
manifestation, et l’on doit alors dire que ce que produit la toile, ce
n’est pas tant l’extériorité que sa pure et simple manifestation. Tout
simplement, la représentation ne représente pas l’extériorité, elle la
laisse se manifester.
Enfin, cette manifestation n’est pas contenue dans l’un des deux termes
de l’expérience esthétique, que sont le spectateur d’un côté et la
toile de l’autre, mais se produit comme l’effet de leur rencontre.
Irréductible à ses éléments, et ne pouvant se manifester que dans
l’écart qui marque en chacun d’eux à la fois le manque et l’excès,
l’extériorité n’est donc rien d’autre que la relation elle-même,
c’est-à-dire l’être de cette relation, sa différence intrinsèque, effet
de la relation entre la toile et son spectateur. Ainsi, puisque les
termes de la relation sont dits être les causes actuelles de l’effet,
et que celui-ci ne réside actuellement en aucun d’eux en tant que
contenu représentationnel, c’est que l’effet est comme tel
virtuel ; virtuel, mais réel, c’est-à-dire effectif. En soi,
l’extériorité n’est donc qu’une relation, au sens pathique et non
logique du terme, et comme toute relation, elle est différentielle et
virtuelle, elle ne peut avoir d’autre forme que celle de ce mouvement
d’actualisation qui se produit entre l’agent et le patient en tant que
résultat de leur passion, de leur rencontre. Et si elle n’est rien sans
eux, c’est qu’elle n’est précisément pas de même nature qu’eux. Effet
de surface donc, ni objet ni sujet, ni patient ni agent, l’extériorité
en tant qu’effet n’est que la relation elle-même, l’entre-deux et la
différence de cette relation, ce qui se joue de l’un à l’autre comme
écart dans la vision, virtuel et réel. Cette troisième forme de limite
est donc celle du régime ontologique, qui nous fait passer, avec
l’extériorité, de ses causes actuelles dans la représentation à son
effet virtuel dans la manifestation. En tant que telle, l’extériorité
de la représentation est donc la formulation index sui du problème de
ses propres limites et nous renvoie a priori à celles-ci comme à ses
conditions de possibilité et d’effectuation. Car, vécue sans pour
autant être visible, l’extériorité est cet effet irreprésentable qui se
manifeste virtuellement dans la vision en tant que différence à soi,
sans pouvoir alors être réduit ou déduit des éléments actuels qui,
comme dans toute relation pathique, s’y opposent et la composent.
III – voyance et renaissance : Hopper platonicien
Tirons les premières conclusions qui s’imposent après cette analyse. En premier lieu, le problème des limites de la représentation se pose en tant qu’interrogation sur la nature de l’apparaître et de la manifestation, il nous engage sur la voie du phénomène et de l’essence de la phénoménalité, au sens premier des termes, et nous renvoie à la dimension de l’apparaître en tant que venue au visible de toute forme de présence. L’idée de manifestation en tant que puissance médiate et actualisée, dévoilée à travers l’apparition de l’étant, et par là la notion même d’invisible, implique que soit alors élucidé le sens de cet invisible qui n’est justement pas la négation, ni même la privation, du visible, mais au contraire son accomplissement, sa différence même, puissance magique du voir atteinte au cœur de la vision en acte : puisque l’invisible ne se produit ici que dans la relation au visible en tant que différence, comme son autre, comme son propre effet d’invisibilité, on peut alors formuler l’idée que voir ici produit de l’invisible. D’où la notion de voyant, et celle d’art de la voyance. La définition de ce que nous appelons voir, en effet, et le sens que nous donnons à l’expérience de la vision, renvoient en définitive à cette expérience originaire du voyant, dont on peut dire dès à présent qu’elle fut l’ultime référence de Hopper à Arthur Rimbaud lui-même, et ce durant toute sa carrière. Depuis Soir Bleu en effet, peint en 1914 au retour du dernier séjour parisien de Hopper, jusqu’à Two Comedians (1965) qui est la dernière toile du peintre, la filiation est plus qu’éclairante, elle est revendiquée. Et en dehors du fait que Hopper lisait Rimbaud et d’autres poètes français dans le texte, évoqués dans la correspondance avec celle qui sera sa future femme, la filiation est perceptible dans la disposition même de cette ultime toile, vue en regard d’un vers des Illuminations. Là où Rimbaud écrit : « il y a une troupe de petits comédiens en costumes aperçus sur la route à travers la lisière du bois » , Hopper peint deux comédiens en costumes blanc s’avançant vers nous, au devant de la scène, sur un grand fond noir et vide. Et à leur droite émerge la lisière d’un bois dont la ramure vert sombre se perd peu à peu dans l’obscurité. Ces deux comédiens ne sont autre que Hopper lui-même et sa femme Jo, venant faire leurs derniers adieux sur le théâtre de l’existence. Le versant éthique de la critique de la représentation doit en effet être compris dans le sens d'une critique de l'existence comme drame.
Ce thème rimbaldien
du voyant est en réalité au cœur de l’œuvre de Hopper. Ne serait-ce que
depuis Rimbaud, c’est le mot d’ordre de toute une génération d’artiste
pour qui la création s’indexe sur ces mots : il faut être voyant, se
faire voyant, comme on peut le lire dans la fameuse lettre à G.
Izambard. C’est la conquête de ce pouvoir de voyance qui motive chez
Hopper la critique de la représentation, et qui implique alors la
nécessité d’en sortir, d’en fixer les limites et d’en trouver l’issue
véritable. Sortir de la représentation en effet, n’a de sens et ne peut
s’effectuer, qu’en vertu de cette quête étrange dont l’aboutissement
est une promesse éthique et métaphysique. En témoignent justement cette
ultime manifestation d’une origine de nature solaire, à travers
la merveilleuse série finale de ces toiles littéralement vouées
au culte du soleil : Morning Sun (1952), A woman in the sun (1961), People in the sun (1960) et enfin Sun in an empty room (1963),
marquent le point culminant de sa recherche. Car cette conjonction de
l’apparaître et de l’invisible dans la manifestation nous renvoie à une
forme hautement spirituelle d’interrogation, qui traduit en réalité le
lien intime de la voyance et de la vie de l’esprit. La vérité dernière
de la voyance est en définitive sa destinée spirituelle : la
conversion du regard est dans le même temps une renaissance à soi de
l’homme en tant que voyant. Or ce thème de la conversion en tant que
renaissance est, de l’aveu du peintre lui-même, d’origine
philosophique, précisément platonicienne. En quoi la question du
Souverain Bien et du Soleil, astre qui chez Platon est conçu comme le
Fils du Bien, est ici au cœur même du projet.
C’est au sujet d’Excursion into philosophy (1959)
: Joséphine Hopper, femme et modèle du peintre, raconte dans le
« record book » où elle prenait note de leur vie commune, que
le livre abandonné et délaissé par l’homme, après la femme sur la
couche, n’est autre qu’un ouvrage philosophique de premier ordre :
« The open book is Plato, reread too late » .
Platon, relu trop tard. C’est-à-dire, la lecture, le livre – autre
grand thème hopperien directement en lien avec le voyage immobile et
l’évasion intérieure – est incapable d’amener l’homme quotidien à ce
que le philosophe ici préconise : apprendre à mourir. C’est-à-dire
au fond, apprendre à désirer, mais d’un désir immatériel et, en quelque
sorte, « décorporé », désir d’une chair marquée par le sceau
chaleureux de la lumière, désir d’un corps baignant dans le rayonnement
solaire. Et le peintre, lui, grand moraliste qui a su se conformer une
telle forme d’ascèse où toute forme de désir et de sensualité se
ramènent à une simple caresse solaire, comme dans Woman in the sun, Sun in a empty room ou encore Morning sun,
achève cette renaissance du voyant à travers l’espace qu’ouvre le
mouvement total de la conversion. Car du Soleil, encore faut-il se
rappeler les propos de Platon, au livre VI de La République,
à savoir, qu’il est le Fils du Bien, c’est-à-dire l’analogon sensible
du Bien, en tant qu’origine de toute forme de génération et
d’apparition de l’étant, source de la lumière, laquelle est est ce
« lien incomparablement plus précieux que celui qui forme les
autres unions ». En effet, dit Platon, « la puissance de voir
comme celle d’être vue émane du soleil, en tant qu’émanation de ce
dernier » ; et « le soleil n’est pas la vue, mais, en
étant le principe, il est aperçu par elle ». Voilà qui scelle pour
de bon le lien entre le peintre et le philosophe dans cette quête
d’invisible et de voyance.
La critique de la représentation en passe donc par une profonde
conversion du regard, qui signifie et exprime d’abord une renaissance
de l’âme. Qu’est cette renaissance, cette expérience spirituelle ?
Qu’est-ce que cette conversion à travers la puissance de la
vision ? Précisément, elle s’enracine et nous ramène en premier
lieu à cette dimension de l’expérience où nous nous révélons à nous
même en découvrant que l'expérience comme telle n’est pas l’issue ou le
fruit d’une origine perdue, mais bien au contraire son ouverture même,
dès lors que la dimension de la conversion nous ouvre, dans le présent,
à l’origine même, à ce phénomène originaire que Platon et les Grecs
appellent « aléthéia », dévoilement ou vérité. C’est à ce
phénomène originaire et solaire que l’œuvre de Hopper remonte, c’est à
ce point ultime qu’elle nous mène. Car la question qui se pose au fond
c’est celle, très platonicienne donc, de la conversion du regard, qui
peut être formulée en ces termes : qu’est-ce que cela fait de
voir ? Quelle différence et quelle exigence cela implique d’être
voyant ? - c ’est-à-dire d’abord, d’être doué d’un pouvoir de
vision qui va bien au-delà du visible comme tel. L’art de la voyance
pose alors la question de savoir quelle différence cela fait
d’être voyant ?
Voilà pourquoi la
notion de « limites de la représentation » nous conduit
directement à l’art de la voyance, en tant que la vision est pour nous
vecteur et puissance de renaissance, de retour à l’origine. Qu’est-ce,
en effet, que renaître ? Renaître, c’est apprendre que
l’engendrement dont nous nous croyons issus n’est pas derrière nous et
n’a pas eu lieu définitivement et une fois pour toute, mais qu’il se
donne dans l’actualité même de l’expérience, dans le présent vivant de
la vie de l’esprit, dans ce mouvement qui exige de revenir à ce qui, en
soi, est originaire. C’est découvrir dans le présent ouvert, l’aléthéia,
que nous sommes à la fois le fruit et le lieu d’un accomplissement qui
est celui-là même de l’origine, c’est donc vivre actuellement l’origine
comme ce qui nous a toujours été déjà donné, mais qui ne peut l’être
que moyennant une conversion de soi à soi où s’illumine la vérité dont
nous nous faisons alors le témoin. C’est, comme le montre chez Platon
l’expérience du petit esclave dans le Ménon, découvrir en son
âme et conscience la réalité vivante de l’inné, du divin et de l’en
soi, et cela ne peut que procéder d’une réelle conversion du regard
depuis les apparitions sensibles jusqu’aux réalités intelligibles en
lesquelles, avant son incarnation, demeure et se tient l’âme
humaine. En quoi, puisque le Souverain Bien est la source même de
l’intelligible et de l’âme, de même que le soleil est source de la
visibilité et des couleurs, renaître signifie une conversion du regard
à l’originaire dans l’expérience toute intérieure que l’on peut en
faire. D’où le souci de découvrir ici ce qui fera, au sein de
l’expérience de la vision, que nous sommes aptes à renaître à nous-même
en tant que voyants, en actualisant notre puissance d’illumination.
La rupture manifestée chez le peintre par cette incomplétude de la
vision, à travers cet effet d’extériorité qui marque les imites de la
représentation, a donc d’abord le sens d’une telle conquête, de ce
retour à l’origine en tant que dévoilement, découverte de ce chiasme
crucial de l’apparaître où voir se convertit en invisible, quand cette
conversion a lieu dans le rayonnement solaire le plus essentiel. La
quête de la voyance et du Souverain Bien solaire n’est pas dissociable,
chez Hopper, surtout à la toute fin de sa carrière, de cette forme de
conversion issue du platonisme qui, partout, appelle l’existant à la
source de l’existence, le visible à l’invisible, et la lourdeur de la
chair à la renaissance de l’énergie spirituelle.
Ce thème de la renaissance appelle donc,
factuellement, des analyses descriptives d’un tel mouvement de
renaissance et de conversion. Nous appelons ce mouvement, dans l’œuvre
de Hopper, la critique de la représentation, en soulignant qu’une telle
critique est elle-même fondée dans ce qu’elle engendre positivement.
D’où, nous allons le voir, un processus à l’œuvre, qui est celui d’un
renversement des valeurs, nécessaire à toute forme de conversion, et où
se dessine un double mouvement de clôture de la représentation – dans
lequel l’espace de la représentation et la spatialité apparaissent
comme le moment du négatif et de la finitude – et un mouvement de
réouverture qui est celui de la renaissance du voyant, de la conversion
à la vie de l’esprit. Le premier, comme mouvement de clôture, porte le
sceau de la négativité parce que la critique nous renvoie à un univers,
celui de la représentation – et les peintures prennent alors pour décor
les lieux mêmes de la représentation : ville, théâtre et cinéma –
où la vie humaine n’est plus elle-même possible. En témoigne alors un
un important travail sur le cadrage et la spatialité conçue comme
dimension finie de la peinture et de l’existence. La vie citadine, le
monde du travail et des loisirs y sont alors décrits dans les termes
les plus durs qui soient : solitude, vacuité, répétition,
automatisme. L’individu moderne n’est plus qu’un automate, un fantôme,
un être inanimé, c’est-à-dire dépourvu d’âme, d’animation au sens
aristotélicien du mot. Et la vie n’est plus qu’une mascarade,
vaste et sombre caricature d’une existence qui a perdu tout son
sens, qui s’est perdue elle-même et se trouve alors dépourvue de toute
authenticité de l’être, de l’exister. D’où une sévère critique,
moraliste et radicale, de l’existence comme représentation, et de ses
pseudo-valeurs.
Le second mouvement, en tant que dépassement du
premier, en est l’issue effective ; c'est le moment de la réouverture
spirituelle et de la manifestation. Car si renaissance il y a, alors le
mouvement par lequel se clôt la représentation en sa spatialité doit
pouvoir être converti et trouver son issue en dehors de l’espace, dans
cette réouverture qui s’accomplit au sein du régime temporel de la
manifestation. Là réside l’essence de l’extériorité en tant que
phénomène d’invisibilité et moment de la conversion de l’âme.
Suivant la voie de la renaissance, mue par la conversion à la voyance,
on peut alors dire que clôture de la représentation et réouverture dans
la manifestation se développent et s'articulent en deux tendances
opposées mais solidaires, puisque c’est en elles que se réalise
totalement le mouvement de conversion. Dans la problématique des
limites de la représentation, clôture et réouverture procèdent donc du
sens même de la vie de l’esprit, en ce que celui-ci exige à la fois une
critique et une renaissance, ce sont là les deux moments inséparables,
les deux faces qui donnent à l’extériorité toute l’ampleur et la valeur
de sa manifestation, et qui font que celle-ci se rattache à la
représentation comme à ses conditions de possibilité et
d'impossibilité. La manifestation est donc ce qui dépasse la
représentation, mais c’est aussi et d’abord ce qui la fonde. De même
que les limites de la représentation ne sont atteintes que du dedans et
à travers le régime de la représentation, son au-delà est son en-deçà,
et ce qui lui échappe est à la fois ce qui la précède et ce qui la rend
possible. Si ce qui s’engage chez Hopper est effectivement un procès et
une critique de la représentation par elle-même, alors il faut
immédiatement souligner que cela ne peut avoir lieu qu’afin de revenir
en-deçà du visible, à l’origine même de sa constitution. C’est donc aux
sources de l’apparaître et de la phénoménalité que la peinture de
Hopper doit nous conduire, en ce moment étrange où ce qui apparaît
surgit avant même de pouvoir se laisser représenter. Reste à mettre à
jour les raisons concrètes qui font que Hopper décide de revenir à cet
en-deçà, à cette origine même de la visibilité, c’est-à-dire, après
Rimbaud, accepte et aspire à se faire voyant.
L’enjeu est donc d’expliquer comment et pourquoi le peintre a déterminé ce double mouvement de clôture et de réouverture de la représentation, afin d’opérer la renaissance du voyant à lui-même, dans le régime contradictoire de la manifestation. Nous verrons que contradiction et manifestation sont en effet deux notions solidaires de l’actualité de l’expérience, dès lors qu’il s’agit de penser la nature même de l’esprit en tant que puissance virtuelle et originaire. C’est parce que la représentation comme telle est aliénation et tromperie, nous détournant de nous-même suivant cet oubli de soi qui est le propre de l’homme, qu’une conversion est d’emblée prescrite, de toute nécessité, laquelle ne peut avoir lieu comme ouverture qu’au cours d’une forme d’expérience intérieure où la puissance de l’esprit est alors ce qui règne en nous et sur nous. Et ce rapport de la représentation à la manifestation, qui est d’abord une exigence spirituelle, ne saurait être résolu autrement que dans et par la contradiction, dans la mesure où la seconde ne peut avoir lieu que comme négation et résolution de la première et où cela débouche sur un phénomène, l’extériorité donc, qui porte en lui même la présence des contraires : en tant que manifestation de l’invisible, l’extériorité est proprement contradictoire en ce que son apparaître repose sur la suppression de ce qui apparaît.
Eric Beauron