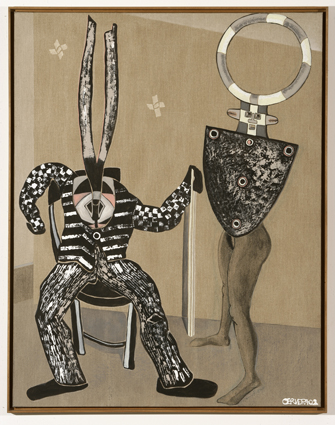 |
Amour hybride
146x114 cm, acrylique et technique mixte sur toile, 2001
copyright : A. CERVERA - photographie : Olivier Maynard
Il nĠest pas rare, dans la peinture dĠAndr Cervera, que la
vie la plus ordinaire ctoie masques et totems, quĠaux ttes dĠhommes soient
substitues des figures animales, et quĠainsi la reprsentation la plus prosaque
soit traverse et comme transfigure par la venue de quelque puissance
surnaturelle. Mais lĠimaginaire nĠest pas ici une faon de sĠloigner du rel :
cĠest le vecteur qui nous permet dĠen scruter le sens. Il est en effet le plus
souvent question de mythes et de sorciers, de magie, de ftes des morts, de
rituels mexicains, dogons ou hindous. Quelles sont les forces qui se saisissent
ainsi de nous – je veux dire des personnages aussi bien que des
spectateurs –, ces
puissances sans visages et en lĠabsence desquelles le peintre semble nous dire
quĠil serait en dfinitive impossible dĠatteindre lĠessence du rel ?
Dans lĠunivers figuratif de Cervera, lĠhomme est en proie
des forces qui le dpassent et cde la place autre chose que lui-mme (dans LĠenlvement
de lĠhomme, le titre dit dj ce que
lĠusage du papier kraft confirme : lĠhomme nĠest plus quĠune petite et ple
figure en creux, la solde des sorciers et de leur danse funeste) ; il
nĠest plus la mesure de toutes choses. En cela, cet univers participe dĠune
forme de sacr o les vnements sont la fois coutumiers, simples, sans
horizon, et dj signes de bien autre chose. Un masque ouvre une telle
frontire, assure un tel passage.
Il nĠest pas rare non plus que lĠon se batte, et parfois le pinceau
lui-mme devient une arme, une lance, dĠaspect phallique (JĠen pinceau pour
toi, Conversation de peinture ainsi que lĠensemble de lĠÏuvre tendent cette
assimilation de la peinture, de la guerre, de la mort et de la sexualit), et
la palette du peintre se transforme alors en bouclier (Conversation de
peinture). Les hommes sont la merci
dĠune menace, diffuse ou bien relle, ils se font dcapiter ou trancher la
gorge (Le purgatoire, Sans titre 2007, Tara), sont
poursuivis grands coups de chaise et de bton. DĠune certaine faon, il en va
ici de la peinture comme dĠun rituel dĠinitiation, o la circoncision,
lĠarrachage dĠune dent, le prlvement dĠun morceau du corps font pntrer
lĠindividu dans lĠespace des hommes faits, cĠest--dire marqus dans leur chair
et capables de surmonter la douleur. Un masque, cĠest galement une tte
coupe, une tte dĠhomme supprime qui laisse la porte ouverte dĠautres
nergies, dĠautres instances. A travers le masque, le visage cde la place
une forme dĠaltrit sauvage dont lĠhomme nĠest plus que le jouet.
CĠest cette violence, par laquelle lĠhomme se fait homme en
sĠaffrontant lui-mme, qui est lĠÏuvre dans les toiles de Cervera –
mais trangement, elle y est toujours associe une forme de joie et de rire,
de fureur comique, qui nĠest pas tant un motif parmi dĠautres que le style mme
du peintre, toujours prompt inclure dans des scnes tragiques des vnements
comiques, ou vice-versa. CĠest sa faon particulire dĠlaborer un thtre
de peinture : la mise en scne y dborde
toujours la nature des vnements qui sĠy droulent.
QuĠest-ce quĠune tte ? Quel
nigmatique horizon sĠouvre par la reprsentation dĠun visage ? La question qui
hantait Giacometti – et laquelle on se souvient quĠAndr Breton rpondait
sans dtour par un lapidaire: Òtout le monde sait ce que cĠest quĠune tteÓ
– prend ici une tournure nouvelle : quĠest-ce quĠun masque ? et surtout :
pourquoi masquer une tte ?
Il semblerait que le masque
restitue sur la toile l'ouverture dessine, dans l'ordre anthropologique, par
cette autre dimension et cet autre espace grce auxquels les hommes cherchent
devenir eux-mmes tout en devenant autres. Le masque implique une dialectique
de lĠidentit et de la diffrence, comme celle qui est lĠoeuvre dans la
reprsentation de lĠhomme figure dĠanimal, si forte dans les toiles de
Cervera. Et la question qui se pose est la suivante : pourquoi se donner des
totems, des anctres non humains, alors
que lĠenjeu est prcisment lĠidentit dĠun groupe dĠhommes ? La culture ne
semblerait pouvoir devenir culture que grce cet trange chiasmeÉ Festin
totmique (1996) reprsente un banquet
dĠanimaux totmiques du Languedoc qui nĠont rien envier aux totems dĠAfrique
ou dĠailleurs. Le loup de Loupian, le bÏuf de Mze, le chameau de Bziers, le
cochon noir de Saint Andr, la chvre de Montagnac, lĠne de Gignac, le
hrisson de Roujan, la sirne de SteÉ sont bruyamment attabls autour dĠune
bouteille comme autant de figures hybrides qui rendent lĠanthropomorphisme sa
vritable fonction. Ce ne sont pas tant les animaux qui sont apprhends par
lĠhomme selon ses propres connaissances ou ce quĠil peut apprendre de lui-mme
– cette critique sera dcidment toujours trop sommaire – mais
plutt lĠhomme qui ne peut se connatre lui-mme quĠ travers cette
identification lĠanimal. Serait-ce l un aspect de sa finitude ? Rien
nĠest moin vident, mais force est de tenir cette finitude pour la consquence
dĠune indtermination foncirement ontologique ; car cĠest de ne pas
savoir ce quĠil est que lĠhomme tire ce perptuel besoin dĠalinationÉ
Au dbut du Mythe et
lĠhomme, Roger Caillois retrace la
gnalogie de la fascination humaine lĠgard des mantes religieuses. Et il
indique que cette fascination tient un point essentiel : la mante religieuse,
parmi tous les insectes, est bien connue pour dcapiter son partenaire aprs le
cot, fait tourdissant qui nous montre, dans lĠordre de la nature, ce que la
culture et le sacr rejouent de leur ct : lĠimprobable identification de la
mort et de la sexualitÉ Il y a ainsi une communaut dĠtre plus profonde que
le partage de la nature et de la culture, dont l'anthropomorphisme se nourrit
bien souvent ses dpends, et dont on aurait finalement trop vite fait de
dpartager ce quĠelle a de rel, dĠimaginaire et de symbolique. CĠest cette
communaut qui est rendue vivante travers les totems, et il est remarquable
que Cervera sĠen soit nourri ds 1994, travers notamment ces figures
languedociennes, avant mme de retrouver au Mali, au Mexique, en Inde ou en
Chine ce culte pour les hommes figures dĠanimaux. Ce qui est profond, ici,
cĠest cette trange angoisse, presque insondable, que lĠon sent poindre chez
des personnages incapables dĠassumer la nudit dĠun face--face avec eux-mmes
sans le recours ce singulier travestissement. Nous nĠosons pas, nous ne
pouvons tre simplement humains, et
masques et totems ne sont pas ici un refuge ni mme le portrait dĠune identit
dtermine, mais le moyen le plus efficace de nous permettre de Òremonter
en de du tournant de lĠexprience humaineÓ, selon lĠexpression chre
Bergson.
La prsence dĠune force donc, dĠune nergie brute, la fois
ancestrale et animale, corporelle et culturelle (sexuelle, guerrire, et
profondment animiste) donne aux scnes reprsentes un coefficient de prsence
que la peinture est souvent la seule pouvoir exploiter, ds lors quĠelle se
saisit de la couleur comme d'un lment en soi – simple jaillissement ou
talement sans vritable vise figurative – et que le trait, ici un cerne
souvent souple et sinueux, sĠtale la fois fluide et farouche. On pourrait
dire que cĠest cette nergie qui nourrit la perception de Cervera et qui motive
son geste – et nĠoublions pas que la notion de sacr est lĠorigine une catgorie de la force, de lĠnergie.
Il en rsulte que la cration dĠune forme ne se fait pas sans
lutte ni combat, qui mobilisent, chaque fois, pulsion de vie et pulsion de
mort. Et cĠest cette lutte qui est ici reprsente – ou plutt qui se
prsente dĠelle-mme en tant que peinture. Le combat, lĠaffrontement, est un
lment constitutif de lĠÏuvre, depuis le dbut (Vive le battre, 1982) – et qui se prolonge souvent travers des
scnes de rivalit rotique, o la relation est davantage affaire de rapport de
force et de dfi que de simple sensualit – et la dynamique dont elle se
rclame est bien celle du dsir : si le dsir est dynamique, ce nĠest pas parce
quĠil se meut du plein vers le vide ou de lĠtre vers le nant, mais parce quĠil
dcoule dĠune tension qui lui est inhrente, entre attrait et rpulsion, liaison et destruction.
CĠest tout le problme du trait et de la forme : que spare-t-on, et comment ?
A cet gard, l'usage du scotch, chez Cervera, a rendu le travail du contraste
plus significatif, puisque les lignes blanches du scotch forment des traits
raides et intransigeants, presque indiscutables, l o le pinceau a tendance
dployer des lignes flexibles et lastiques propices la fusion, au mlange,
l'effusion de la couleur. L'volution gnrale, trs nette, vers une forme
d'puration du fond et des couleurs est alle de pair avec une accentuation des
contrastes des lignes et des formes lie l'exploitation de matriaux nouveaux
comme le kraft et le scotch. La dcouverte parfois fortuite de nouvelles
techniques n'est jamais une simple contingence dans le travail d'un artiste,
mais le plus souvent une faon de donner aux Ïuvres une cohsion et un sens
plus forts, comme si cette volution n'tait au fond que le fruit complexe du hasard
et de la ncessit. Ici, le kraft et le scotch vont de pair, ils relvent d'une
innovation la fois matrielle et formelle, plastique et hautement
significative, puisque cĠest ensemble quĠils confrent aux toiles cette
matrise impulsive, cette apparence d'improvisation mle de droiture et de
rigidit. On assiste bien lĠaffirmation dĠun style, ce qui signifie une
synthse matrielle des thmes chers lĠartiste.
La peinture comme le dsir nous renvoient donc essentiellement
une nergie qui dploie par nature deux tendances opposes, et qui tire sa
puissance de cette opposition mme. On se souvient que, dans LĠAbrg de
psychanalyse, Freud lui-mme nĠhsitait
pas se rclamer dĠEmpdocle lorsquĠil sĠagissait dĠapprofondir la nature de
la pulsion lĠÏuvre dans le psychisme humain, et quĠil dfinissait alors tout
phnomne vital comme un mixte de lĠinstinct de vie et de lĠinstinct de mort.
Toute forme, tout phnomne, est un mlange des deux principes empdoclens de
lĠAmour et de la Haine, de lĠattraction et de la rpulsion, qui prsident
toute manifestation de la vie : si Eros et Thanatos ne sont donc pas des
pulsions antithtiques, mais bien les deux visages d'une seule et mme pulsion
modelant chaque phnomne, si la vie elle-mme est Òune lutte ou un compromis
entre ces deux tendancesÓ comme lĠaffirme Freud, alors on peut dire que la
peinture, chez Cervera, nĠest pas simplement un espace de reprsentation mais
le lieu o cette lutte sĠactualise dans sa dimension originairement plastique –
et les masques et les totems sont chez lui autant de prismes o se rfracte la
pulsion, o rayonne un dsir aux multiples figures. Amour et Haine, attraction
et rpulsion sont dĠabord des coordonnes picturales : non pas des matriaux du
peintre, mais les principes mmes de son art.
Cette lutte, cette manifestation conjointe de forces
contraires, se manifeste en partie travers le rapport, trs thtral chez
Cervera, entre le dcor et lĠaction. On remarquera en effet que le rythme des
peintures de Cervera provient dĠune certaine tension entre la faon dont les
murs et les sols sont reprsents et lĠvnement qui sĠy droule. Les premiers
dlimitent le plus souvent un lieu, intrieur et clos, une forme de scne
marque par des motifs gomtriques (petits carreaux, bandes bichromes, fines
ou larges, verticales ou horizontales, ou encore surface monochrome), qui
installent une rgularit et tendent crer un quilibre, une forme de
stabilit. Mais cet quilibre est en ralit toujours prcaire. Car si le dcor
de la scne est fait pour maintenir les lments qui sĠy trouvent, lĠaction qui
sĠaccomplit ne peut en ralit y tre contenue : quĠil sĠagisse dĠune course
poursuite ou dĠune course en pousse-pousse (Les voleurs de masques, Rickshaw Calcutta),
dĠun Ç enlvement È (LĠenlvement de lĠhomme qui prend lĠallure dĠune danse guerrire), dĠun duel ou
dĠun cauchemar (Conversation de peinture
et Cauchemar du fumeur dĠopium, o la
pice est envahie par les figures animales du rve) ou encore dĠun crime
passionnel (Sans titre 2007), on peut
dire que le drame, lĠaction en cours, implique gnralement des personnages
rsolument incapables de tenir en place. Mme Le cauchemar du fumeur
dĠopium, dont le personnage central est
pourtant allong en train de fumer, est une toile en mouvement : les
animaux mergent du haut et du bas du cadre, la serveuse de th sĠloigne
pendant quĠapparat dans le fond, comme surgissant dĠun rideau de thtre
– procd qui revient dĠailleurs dans dĠautres toiles – un trange
personnage vert, le tout dans un espace o figures du rve et de la ralit
participent du mme vnement. Si cette mise en scne est thtrale en tant que
telle, cĠest parce que le peintre donne chaque personnage un rle dans une
action commune, il les lie ensemble au sein du mme drame et ne les spare
jamais.
A ce travail sur lĠespace
et le mouvement sĠajoute une forme de synthse temporelle qui conjugue
diffrents moments de lĠaction, la cause et sa consquence, lĠavant et lĠaprs
tant souvent peints ensemble sur la toile. Dans Sans titre 2007, le mari jaloux gorge lĠamant pendant que la femme a dj
pris la fuite et sĠloigne dans un coin du tableau, et lĠon devine toute la
panique et la surprise qui ont prcd, lors de la dcouverte du forfait des
amants. Ici comme ailleurs, lĠaction est reprsente au moment o les nergies
en prsence se conjuguent et sĠaffrontent, sĠintensifient, et tmoignent dans
le prsent de la charge des actions passes. On pourrait alors interprter cet
instant paroxystique comme la co-prsence, sur la toile, dĠun mythe, drame
originel et rcit fondateur, et dĠun rite, ensemble des actions senses le
rpter afin dĠen assumer la charge cathartique – lĠensemble des toiles
faisant ainsi penser une grande srie visant rappeler lĠunit indissociable
dĠun pass originaire et du prsent qui sĠy rapporte, afin de dlivrer les
hommes des passions qui les animent. Mais les hommes sont oublieux et ils ne
savent pas de quel rcit ils sont les protagonistes, ni de quel destin ils sont
les marionnettes.
Mouvements, peurs, rves,
dsirs, actions et affects animent donc les corps et les esprits de telle sorte
que lĠaction en cours nous parle dĠun vnement qui nĠest jamais simplement
la mesure du lieu et du temps o il se droule (un sacrilge, un vnement
mythique, un sacrifice, un mauvais rve dans une fumerie dĠopium, etc.). Cette
tension provient en dfinitive du fait que cĠest bien une puissance
transcendante, une force sacre qui se propage dans un espace-temps profane, et
qui dchaine alors chez les personnages une nergie indite, puisquĠil sont
dsormais en proie quelque puissance extraordinaire. Si le sacr nourrit
Cervera travers ses voyages (notamment ses deux sjours en pays Dogon au
cours desquels il a t amen, en 2001 et 2002, sĠinitier de prs aux cultes
animistes), si la pense magique visite ses Ïuvres, alors on peut dire que son
problme est de trouver, en tant que peintre, un style qui, sans corrompre
cette source la fois trangre et familire, puisse en restituer la
dimension extraordinaire, en entendant
bien travers ce terme la difficult majeure quĠil recle : comment ressaisir
dans lĠespace des hommes les puissances qui le traversent et le travestissent,
lĠintensifient et le transfigurent – sans les dnaturer ? Il semble
lĠvidence quĠ partir du moment o les hommes sont lis au sacr, lĠespace qui
les entoure ne soit plus en mesure dĠaccueillir de telles forces, de tels
drglements. Il y a un changement dĠchelle, une forme de dmesure, et cĠest
cet cart qui donne de nombreuses toiles leur intensit : cette Ïuvre
est empreinte dĠun rythme et dĠune dynamique qui sont toujours, et en toute
lettre, une faon de sortir de soi-mme, une extase au sens grec du terme. Et cĠest cette extase qui est aussi
vise par les masques, car ce sont eux qui, au sein des toiles, mettent en
mouvement ce perptuel dsquilibre entre dcor et action, pass et prsent,
imaginaire et ralit. Thtre de peinture qui est aussi un thtre du sacr,
cĠest--dire une scne o lĠvnement est la fois tragique – puisque
lĠhomme y est lĠobjet de puissances suprieures – et dtourn de sa
tragdie, et par l-mme comique (le sorcier poursuivant les voleurs de masques
coups de chaise et de bton, la mort jouant du banjo, les masques qui tirent
la langue, etc.), ordinaire et pourtant soustrait sa trivialit.
Nous n'avons
cherch ici qu' clairer le rythme et la puissance dĠune Ïuvre qui a le
privilge de puiser ses motifs et ses formes dans des cultures o le sacr est
encore dĠune actualit certaine. Et Portrait de famille dit bien, en ce sens, la difficult affronte, lĠacte de
clture et de fermeture quĠopre malgr elle la reprsentation par lĠimage, en
cherchant, par le trait et la forme du cadre, contenir les personnages ; figs
et raidis, runis cte cte, immobiles et emprunts, ils obissent ici au
geste dĠun photographe dont les indications visent une mise en scne quelque
peu grotesque, cĠest--dire proprement trangre aux corps, aux mouvements et
aux coutumes quĠelle tente de domestiquer ; et qui est ici regard par le
chien ? LĠironie bien sr est quĠil sĠagit du photographe lui-mme, devenu
lĠobjet dĠune curiosit canineÉ parce quĠayant introduit dans la maison lĠobjet
qui brise son fragile quilibre, indiffrent aux
masques et aux puissances quĠils couvent. Le problme du peintre est ici
– mais pas seulement – quĠil lui faut parvenir figurer ce qui
nĠest pas destin tre reprsent. Et il semblerait que cette forme de
figuration, dont l'nergie provient en partie de son apparente navet, et dont
on peut dire quĠelle est peu peu devenue
trangre au regard contemporain, soit ce qui a toujours t le plus familier
Cervera.
Eric Beauron