Dans
le labyrintheÉ
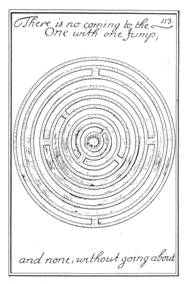 |
(D. A. Freher, Paradoxa
Emblemata, manuscrit, XVIIIme sicle).
Tous les commentateurs,
mythographes ou historiens, ont soulign la svrit du labyrinthe aux murs
inamovibles de granit, et ont song en tout premier lieu aux murs opaques de
l'impitoyable labyrinthe crtois du minotaure. Seuls ceux qui ont d'exprience
t aux prises de mystrieux labyrinthes savent qu'il n'en est rien ; que,
comme nous, les labyrinthes sont faits d'une toffe moins rigide et d'un plan
moins rigoureux. Rien de moins rassurant que la chair qui nous enveloppe et
nous enferme ressemble notre propre chair.
Ainsi en va-t-il des espaces
premiers qui n'ont pas grand-chose de sols stables ou
de routes bien traces. Pas de plan du labyrinthe, on doit le vivre pour
voir. Nos pas sont compts, on en fait mme le compte
machinal par peur de se perdre, et c'est parfaitement inutile.
Le labyrinthe est une prison o la
vie s'veille.
Le labyrinthe qu'on dessine tel un
masque nous guide comme le masque blanc au thtre. Il n'est ni sombre, ni
lumineux, ni mensonge ni vrit, et il est harassant au philosophe parce qu'il
peut la fois tre et paratre, et ni tre, ni paratre.
Le labyrinthe s'invente chaque
fois qu'on avance son pas, qu'on pousse une porteÉ Il est un cachot d'o la vie
s'panouit.
La souffrance primordiale des
espaces premiers provient peut-tre, dirait le plerin spirituel, d'une
nostalgie de l'unit, d'une scission du symbole comme totalit une. Comme
l'crit Salmon dans son Dictionnaire hermtique
(1645), "Par cette Fable les Sages ont entendu leur Mercure participant
des deux natures, mle et femelle : autrement, de la nature animale et de la
minrale, qui sont enfermes dans le Labyrinthe, qui est l'Ïuf
hermtique." Etre Ç press È dans un labyrinthe comme dans une
boule, un Ïuf ? Ç Souffrance primordiale È est un caractre
nietzschen du pathos dionysiaque, soit : de
l'essence de la musique et de la posie comme force. Il y a bien une
"souffrance primordiale", une souffrance archaque et premire, nous
disent Nietzsche et Bachelard. Mais par un miracle incomprhensible,
l'archaque souffrance personnelle est aussi l'ombre traverse des fondations
du monde.
Il est impitoyable, ce labyrinthe,
ne laissant de nous presser poursuivre son arpentage (le ntre) et ses
trajectoires nombreuses taches d'ombres contradictoires, de dalles glissantes,
de portes souvent fermes sur des impasses, de piges et de fausses indications
(les ntres).
Dans l'air circulent des sons et
des feux qui sont des signes. Le parcoureur y cherche des analogies.
Le labyrinthe lui-mme tait une
voix; le cloisonnement des espaces et des temps tait notre seule opration.
Chaque pas est souffrance
maintenir comme telle, autant que l'ide qui dpeint cette souffrance en la
limitant ce mme pas. La "dmarche" dans le labyrinthe a pour effet
de montrer, ou de faire avouer en discours ce qui est natur et naturant en
celui qui erre, en le reprsentant sous ses yeux et autour de lui.
Les murs de pierres et les parois
en chicane sont en ralit de minces membranes. L'hostilit froide s'avre,
force de voir, accueil chaud d'un lit de chair.
Fines dentelures, murs d'eau
verticale, voil ce quoi ressemble ce ddale de sang et de tissus
embryonnaires.
Dans un labyrinthe vierge, ou
virginal, et trs chaotique d'effets dvastateurs de la souffrance primordiale,
le pote le plus sagace (le plus habile, devant presque sans cesse se partager
et se rassembler entre croyance et vrit) rpartira les lieux traverss par
groupes de lieux : Enfer, Purgatoire, ParadisÉ au sein desquels il donnera
demeure des personnages importants au regard de sa vie personnelle comme de
l'histoire des hommes.
"Sois avise, Ariane! dit
Dionysos dans La plainte d'Ariane de NietzscheÉ
Tu as de petites oreilles, tu as
mes oreilles :
mets-y un mot avis! -
Ne faut-il pas d'abord se har, si
l'on doit s'aimer ?É
Je suis ton labyrintheÉ"
Prenons garde de ne pas traverser
trop vite, fuyants aux oreilles courtes et aux yeux encore cills.
"Qui sait donc en dehors de
moi ce que c'est qu'Ariane!"
Elle est le labyrinthe elle-mme,
trs petite dans ta main que tu crois possder, trs grande dans le domaine
architectur que tu crois parcourir. Je construis un labyrinthe
seulement pour m'y perdre...
Le fil rouge qui me guide, regard
de plus prs, est en lui-mme tresse et spirale, cheveau de segments fluides
sans bords. Dans mes mains coulissant sur la rampe de corde libratrice, je vois
un autre labyrinthe dans le labyrinthe. Des nÏuds et des fils dedans comme
dehors, dans l'espace qui se referme sur moi. A la posie de dire l'impossible
rencontre d'inconciliables. Le fil du discours dont le droulement est
perptuelle cration a le double sens d'un discours de la souffrance ; il
en est l'expression propre, et le discours d'un autre qui exprime cette
souffrance.
Nous ressemblons ce "rveur
labyrinth" (Bachelard); arpenteur de faux horizons se retournant hagard
sur ses pas dj effacs. Le labyrinthe condamne la mmoire linaire et
cumulative qui forme le Ç discours d'entretien È de ce que l'on est.
Il n'y a pas de centre, pas de
minotaure, sinon l'Ïil flottant du Monoculum de
Paracelse qui regarde un instant notre regard stopp, et fait de nos voyages
des mondes loquents.